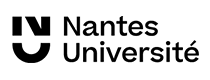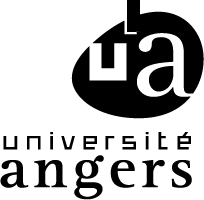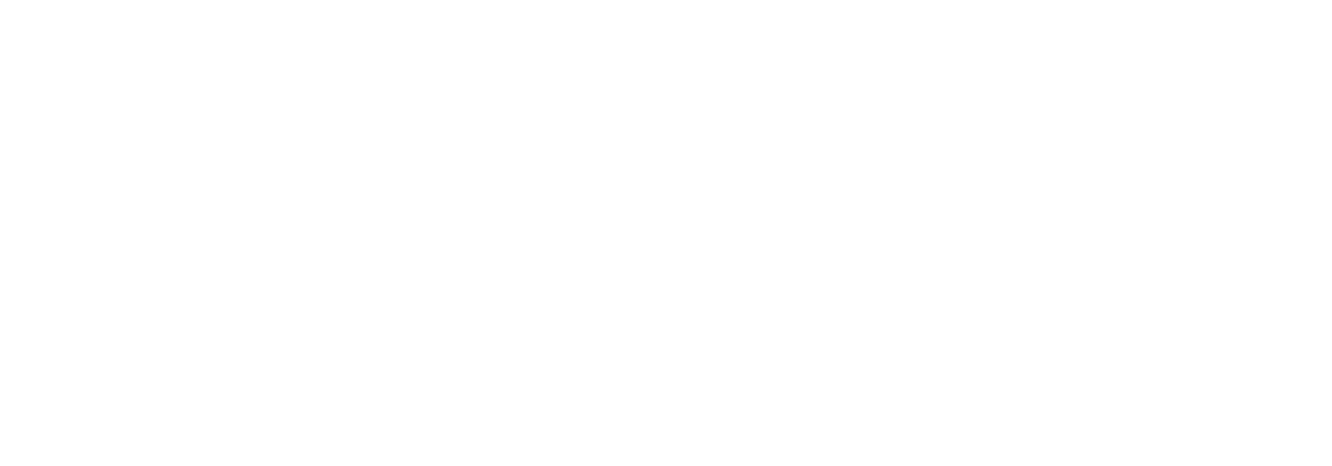- Recherche
Présentation des travaux des nouveaux EC du laboratoire : Anaëlle CAMARDA, Sandie MEILLERAIS, Katarina PAVIC et Damien RIDREMONT
-
Le 09 octobre 2025Salle T065-T067, bâtiment Tertre, Nantes Universitéfalse false
-
14h00-17h00
Anaëlle CAMARDA
Maîtresse de Conférences
en Psychologie du développement
à Nantes Université
Résumé de l’intervention :
Dans cette présentation au LPPL, je présenterai sur mon parcours de recherche depuis ma thèse, en mettant l’accent sur les travaux que j’ai menés autour du développement des capacités de génération d’idées créatives. L’objectif sera de donner une vision d’ensemble de mes recherches passées et actuelles, mais aussi d’ouvrir des pistes de réflexion sur de possibles collaborations au sein du laboratoire.
Je présenterai mes travaux à partir de 3 axes : Le premier concerne l’étude des mécanismes cognitifs impliqués dans le dépassement des effets de fixation, ces blocages cognitifs qui apparaissent lors de tâches de créativité et qui empêchent souvent les individus de produire des idées nouvelles. À partir d’une modélisation cognitive de la génération d’idées, j’ai cherché à identifier les processus qui permettent de surmonter ces blocages, en mobilisant notamment les théories des doubles processus.
Le deuxième axe porte sur les contextes sociaux dans lesquels la créativité s’exprime. Mes recherches visent à comprendre comment certaines situations sociales – par exemple les situations de brainstorming – peuvent soit stimuler, soit réduire le potentiel créatif des individus. Ce travail permet d’analyser la créativité non seulement comme un processus cognitif individuel, mais aussi comme un phénomène façonné par les dynamiques interpersonnelles et culturelles.
Enfin, le troisième axe s’intéresse aux outils et dispositifs concrets qui peuvent être proposés pour développer la créativité, en particulier dans des contextes scolaires. L’enjeu est d’identifier des méthodes pédagogiques et les caractéristiques des outils qui permettent aux jeunes d’amplifier leur potentiel créatif, tout en tenant compte des contraintes institutionnelles et culturelles.
Sandie MEILLERAIS
Maîtresse de Conférences
en Psychologie clinique
à Nantes Université
Titre de l’intervention :
Enjeux théoriques et cliniques en psychothérapie.
Résumé de l’intervention :
Cette présentation propose un aperçu de mes recherches en cours au sein du LPPL et en collaboration avec des partenaires extérieurs.
Plusieurs projets sont actuellement développés au sein du LPPL. Notamment, une étude qualitative sur la manière dont les femmes atteintes d’endométriose gèrent leur douleur au quotidien ; une recherche sur l’évaluation et la qualité de photolangages ; et une analyse de l’incidence du pouvoir dans les contextes thérapeutiques, dans ses dimensions tant positives que négatives.
Parallèlement, des collaborations avec la Belgique ou Toulouse auprès d'instituts de formation en thérapies systémiques visent à approfondir l’analyse des processus thérapeutiques lors de l’usage d'outils de médiation (grâce, par exemple, à la méthodologie de l'Entretien d'Explicitation), et à développer puis évaluer des modules de formation d’outils réflexifs issus de ma thèse.
Katarina PAVIC
Maîtresse de Conférences
en Psychologie cognitive
à Nantes Université
Titre de l’intervention :
Vers une meilleure compréhension des capacités socio-émotionnelles préservées dans le vieillissement.
Résumé de l’intervention :
Mes travaux s’articulent autour d’une question centrale, visant à comprendre comment les processus socio-émotionnels évoluent au cours du vieillissement. Dans le cadre de cette présentation, j’exposerai mes recherches sur l’identification et la réactivité émotionnelle. Traditionnellement, ces processus et leurs changements avec l’âge ont été étudiés à partir de stimuli peu représentatifs des situations entourant nos expériences émotionnelles réelles. La réalité virtuelle est apparue comme un outil pertinent dans ce contexte, car elle offre un compromis unique entre contrôle expérimental et réalisme des stimuli. Cette approche expérimentale innovante a permis de mettre en évidence 1) le maintien des capacités de transmission de signaux sociaux dans un contexte social interactif, et 2) une réactivité émotionnelle préservée, voire amplifiée avec l’âge, en réponse à des stimuli de valence positive. Pris ensemble, ces résultats offrent une vision plus nuancée du vieillissement émotionnel, à contre-courant des travaux centrés habituellement sur le déclin de ces capacités avec l’âge.
Damien RIDREMONT
Maître de Conférences
en Psychologie clinique
à Nantes Université
Titre de l’intervention :
Stress et burnout des professionnels travaillant auprès de personnes en situation de maladie et/ou de handicap.
Résumé de l’intervention :
Mes travaux de recherche s’inscrivent dans le champ de la psychologie clinique et de la santé, et explorent la souffrance psychologique et la santé au travail des professionnels intervenant auprès de personnes en situation de maladie et/ou de handicap. Mon expertise porte plus particulièrement sur les concepts de stress professionnel et de burnout. Concernant les professionnels de santé, le stress et le burnout entraînent une baisse de la qualité et de la satisfaction des soins, ainsi qu’une dégradation de la relation soignant–soigné (Hall et al., 2016 ; Salyers et al., 2017 ; West et al., 2018). Le stress et le burnout des enseignants ont, quant à eux, des conséquences sur la relation enseignant–élève, les résultats académiques ou encore la motivation des élèves (Madigan & Kim, 2021 ; Wong et al., 2017). La qualité du lien enseignant–élève semble particulièrement importante pour les élèves avec un trouble du spectre de l’autisme, notamment lors des transitions scolaires qui constituent des périodes de vulnérabilité pour les élèves, leurs parents et les équipes éducatives (Danker et al., 2016 ; Nuske et al., 2018). Améliorer la santé au travail de ces professionnels, c’est donc avoir un impact significatif sur le parcours de vie des personnes qu’ils accompagnent. Pour cela, il est indispensable d’explorer les facteurs relatifs au travail et à l’individu, qui engendrent ou protègent du burnout. La connaissance de ces déterminants guide notamment la mise en place d’interventions organisationnelles (changements structurels dans l’environnement de travail) et individuelles (e.g., centrées sur les stratégies de coping, thérapies comportementales, cognitives et émotionnelles). Ainsi, je présenterai brièvement les travaux que j’ai menés et auxquels j’ai contribué sur cette thématique.
Sur le plan théorique, malgré un demi-siècle de recherches sur le burnout, plusieurs questions demeurent au sein de la communauté scientifique (Demerouti & Bakker, 2025 ; Edú-Valsania, 2022 ; Nadon et al., 2022 ; Schaufeli et al., 2023) : peut-on s’accorder sur une définition du burnout ? Constitue-t-il une entité nosologique à part entière ? Quel modèle théorique en offre la meilleure explication (e.g. exigences–ressources, conservation des ressources, modèle transactionnel du stress) ? Quelle est sa dynamique temporelle ? Et quels dispositifs d’intervention sont les plus pertinents ? Ces questions seront abordées, car elles constituent des axes de recherche que je souhaite développer dans les prochaines années.